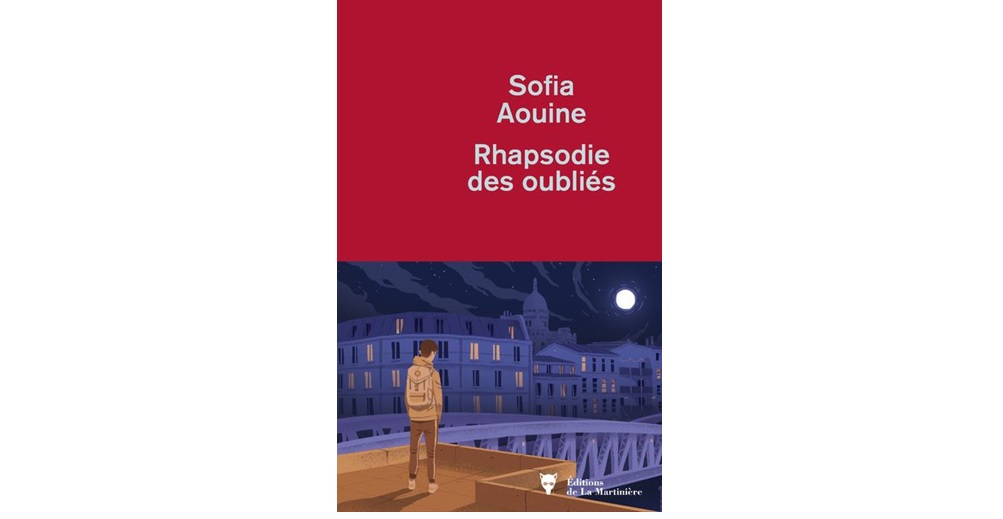(Mise à jour – Ce livre a reçu le Prix de Flore 2019) – Perché en haut des immeubles de Barbès, comme l’illustration du bandeau par Nicolas Galkowski le figure, Abad brosse le portrait de son quartier tel qu’il le voit, à travers son regard d’adolescent turbulent et rêveur. Rhapsodie des oubliés, premier roman de Sofia Aouine aux Éditions de La Martinière, donne la parole, vive et franche, à ce guide effronté qui nous emmène dans les rues de la Goutte d’Or (Paris XVIIIe), où les grandes espérances slaloment entre misère urbaine et détresse humaine.
Depuis le départ de son Liban natal, Abad est devenu un Antoine Doinel malgré lui. Au demeurant, les allusions au héros des Quatre cents coups fourmillent entre ces pages où Abad, comme lui, est incompris par ces adultes qui semblent avoir oublié ce que c’était d’être enfant. Embourbé dans la rue Léon, sordide et pourtant si familière, le jeune garçon, “animal affamé dans les poubelles à souvenirs”, empoche les instants vécus et racontés, sans les trier, afin de ne rien perdre de ceux et de celles qui s’effacent derrière sous le joug d’un frère radicalisé, la honte de se retrouver sans travail, ou bien dans les escaliers conduisant au sexe monnayé.
La playlist des oubliés se joue dans la rue
Comme dans un bon vieux rap à la MC Solaar, l’écriture de Sofia Aouine a de ces envolées lyriques qui vous plaquent ensuite face contre sol, le nez dans les dures réalités. L’autrice confère ainsi au jeune Abad un sens de la formule où l’argot vient percuter la zone de confort du lecteur : nous lisons et relisons la phrase pour sa beauté incisive, spontanée et réaliste, mais aussi pour encaisser la vérité du propos. La rengaine de ce premier roman est nouvelle, au-delà des stéréotypes médiatiques sans cesse rabâchés : elle nous entraîne sur le “boulevard des rêves brisés”, jusque dans l’intime des sans-sommeil et des sans-amour, qui ne demandent pourtant que ça.
Pendant notre lecture, on entendrait presque la voix grave de Nougaro chanter sur la bande son du film de la rue : “Les filles qui ont la peau douce la vendent pour manger” (Bidonville). À Barbès, chaque parcelle de trottoir est un bout de territoire, où circulent trafics et menaces des caïds. Parmi eux, Abad ne succombe pas aux sirènes de l’influence et de l’argent faciles, préférant la compagnie des femmes et des livres.
Les livres et les femmes, paravents d’un monde précaire
Contrairement aux personnages féminins, les hommes semblent céder à la violence et au renoncement. Ne pas être comme le père, telle est la devise d’Abad, qui s’entoure de Gervaise, Odette, Édith, et de Batman/Nour la fille d’en face cachée sous le voile. Figures consolatrices, elles ouvrent leurs bras et leur cœur à l’adolescent, et prennent parfois la parole pour raconter leurs propres périples, donnant à ce premier roman une écriture mosaïque. Certaines d’entre elles sont des lectrices, des écrivaines en devenir. Abad devient grâce à elles un lecteur sincère, nous confiant sans détour : “C’est chiant mais bien écrit et ça fait paravent avec le monde.”
Ces reines de Barbès croulent sous les dettes ou bien les intimidations. Avide de tendresse, Abad rejoint ces femmes qui viennent de loin, de par leur passé, leur pays d’origine ou encore ce qu’elles subissent quotidiennement. Au milieu de cette “ambiance de fin du monde”, le jeune homme trouve leur affection salvatrice.
“Immigré.e.s”, et toutes ces étiquettes qui démangent
Barbès, quartier des oubliés, les immigrés qui pourtant ont tous “une histoire de valise à raconter” mais qui, à force de ne plus être écoutés, se sont enfermés dans leur mutisme. Le roman de Sofia Aouine est le témoignage des incompris. Abad le premier est appelé le primo-délinquant, le “marara” (le fils de “l’amertume”, en arabe), autant de sobriquets qui atrophient sa personnalité et son l’avenir.
Tous les habitants du quartier sont victimes des étiquettes réductrices, mais aucun élan de solidarité tente de les balayer. Dès l’école, chacun reste à l’intérieur d’une case trop étroite, dans son propre malheur, jaugeant son voisin. Le roman met subtilement en garde contre cet isolement qui provoque une sorte de suicide collectif, d’où ne peuvent éclore que des idées radicales. Naissent alors “ces clowns étranges et perdus, reflet d’une partie de la jeunesse de ce pays”, comme les décrit Abad.
Dans son roman Une désolation, Yasmina Reza disait : “La route du bonheur est peut-être la route de l’oubli.” Abad prend le contre-pied de cette citation. Pour lui, l’oubli n’est ni possible, ni enviable, et il se positionne comme la mémoire de tout un quartier, pour le plus grand plaisir des lecteurs.
Pour lire un extrait de Rhapsodie des oubliés disponible en numérique et au format papier Cliquez ici ou Cliquez ici